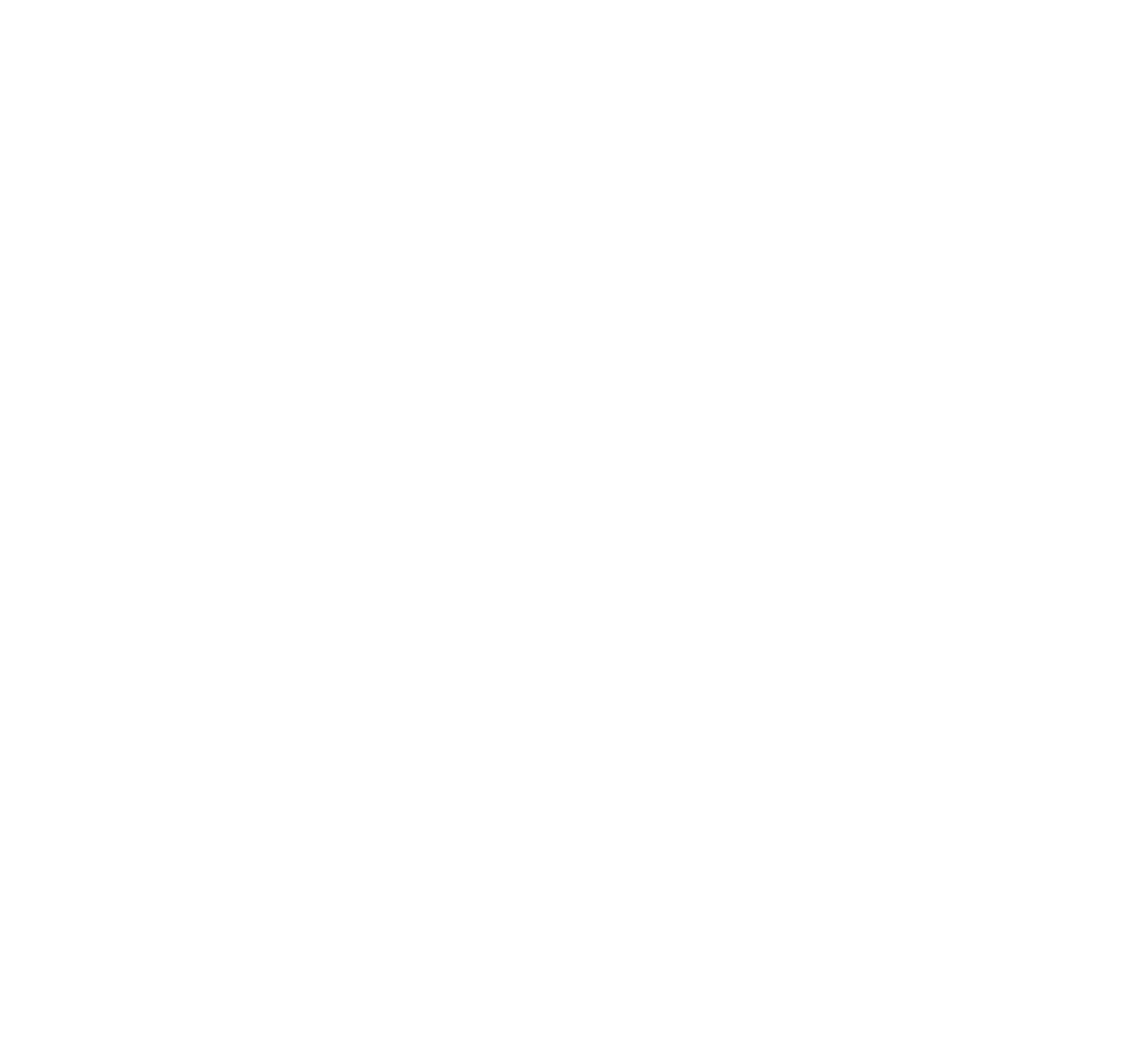La culture du mystique, un patrimoine mémoriel
Patrimoine : Bien qu'on tient par héritage de ses ascendants.Ce qui est considéré comme un bien propre, une richesse : Son patrimoine, c'est son intelligence.Ce qui est considéré comme l'héritage commun d'un groupe : Le patrimoine culturel d'un pays.Ensemble des biens, droits et obligations ayant une valeur économique dont une personne peut être titulaire ou tenue.Ensemble des éléments aliénables et transmissibles qui sont la propriété, à un moment donné, d'une personne, d'une famille, d'une entreprise ou d'une collectivité publique.
©Larousse
Avant-propos : En compagnie de Valérie Rodney, écrivaine et bloggeuse martiniquaise, nous discutons de la place du magico-religieux aux Antilles et de sa préservation.
Mélissa : Je cite : « Personnellement, j'ai vu et mon entourage également a été témoin de choses occultes et cette expérience m'a permis d'aiguiser ma plume et de les retranscrire à travers des contes qui, j'espère, préserveront notre culture et imaginaire collectif ». Bonjour Valérie, comment vas-tu ?
Valérie : Bonjour ! Man ka tjinbé [1] ! Merci de m'avoir invité pour ce débat.
M : Je suis très heureuse de t'avoir puisque je suis ton compte Instagram depuis un moment. Alors qui de mieux que toi pour parler des esprits ? La citation que je viens de citer, elle est de toi, plus exactement de la description de ton récent projet « Témoignage des mystères de nos îles ». Je crois que j'aurai 2 ou 3 histoires à te raconter moi-même, mais peut-être qu'elles sortiront au cours de cet échange. J'ai parcouru et lu ton travail sur le monde du magico-religieux, que tu décris comme étant une bataille contre l'assimilation de nos cultes pour préserver notre imaginaire collectif. Et je me suis dit : « Oui, parlons-en ! ». Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Valérie dis-moi, qui es-tu ?
V : Alors pour commencer, je m'appelle Valérie Rodney. Je vogue vers mes 30 ans bientôt et je suis une Martiniquaise qui vit actuellement depuis 7 ans en Île-de-France où j'exerce le métier de manipulatrice radio dans un cabinet privé à Paris. Rien à voir ce que je fais actuellement et rien à voir mes études scientifiques non plus. J’ai pour projet cette année, j'espère, je touche du bois, de rentrer chez moi pour août parce que tchou an mwen bon épi [2] la France !
Justement, à force de prendre le métro, il fallait bien que je trouve une occupation. Je n'allais pas rester tout le temps sur mon téléphone. J'ai trouvé la littérature, les livres. La littérature antillaise m'a permis de garder le lien intact entre mon île et moi parce que j'étais tellement nostalgique. Je déprimais tellement que j'avais besoin de ça avec la musique et la littérature, ça me permettait de me faire un petit cocon et de croire que j’étais toujours en Martinique, dans les cancans, dans les histoires, et cetera. Et donc à force de lire, j'ai pu accumuler certaines connaissances. Je ne lis pas que la littérature antillaise. Je lis la littérature africaine, un peu japonaise et anglaise. Ça me permet de voguer dans les différentes civilisations, mais je me suis plutôt orientée sur la littérature antillaise et africaine. Et à force de lire, j'ai pu voir certaines ressemblances entre les cultures africaines et les cultures de la Caraïbe. Ça m'a permis de créer mon projet il y a 2 ans c’est-à-dire ouvrir ma page Instagram et mon blog La fleur curieuse. Avec mes modestes moyens, j'essaie de faire le pont entre l'Afrique et la Caraïbe grâce à mes différentes lectures et recherches.
M : Oui et tu y parviens très bien ! Créer un pont est nécessaire que ce soit entre l'Afrique et la Guadeloupe. Et qu’on le veuille ou non avec la France et les Antilles. C'est vrai que c'est nécessaire. On sent que la communauté qui te suit te remercie quelque part du projet que tu fais et c'est très beau.
V : Je tiens aussi à préciser qu’il y a le pont avec l'Afrique mais il ne faut pas oublier l'Inde, la Chine et l’Europe. J'essaie de développer sur l'Inde. La Chine, c'est un peu plus compliqué parce que l’on n’a pas tellement d’écrits sur l'immigration chinoise et les cultures, c'est très discret. J'essaie malgré tout. J'espère qu’en Martinique je vais trouver des gens pour parler de ça parce que c'est important. Quoi que l’on dise une famille antillaise, il y a un peu d’indien·ne, un peu d'africain·e, un peu de chinois·e, un peu de blanc·he, un peu de libanais·e. C’est un migan [3] ! Il faut en parler. L'Afrique c'est la matrice de tout et qui tient tout mais il faut aussi parler de l’Inde et de la Chine. Illes ont apporté leur petite touche qui rend l’antillais·e unique ! On aura beau dire, lia caribéen·ne de base est unique, c'est quelque chose franchement !
M : Dans ton projet ce qui revient très souvent depuis que tu as démarré la Fleur curieuse, c'est ton intérêt pour le magico-religieux.
V : Au fur et à mesure, j'ai commencé à développer ce thème parce que j'ai vu que ça apportait beaucoup d'intérêt et ça m'intéressait énormément, donc j'ai commencé à creuser cet univers qui me fascine tellement !
M : Et qu'est-ce qui t’a mené à cet intérêt ? Quand et pourquoi as-tu développé cet intérêt ?
V : Alors tout a commencé lorsque j'étais petite. Je passais mes vacances scolaires chez ma tante en Guadeloupe. Ma tante aimait beaucoup me raconter la nuit des contes et des mystères. Je ne savais même pas si elle inventait ou si c'était vrai parce qu'elle était tellement convaincante. Elle me disait : « Attention, il y a les yeux rouges qui te regardent. Fait attention ! ». Alors moi, j'avais peur surtout qu’elle habitait dans l’un de ces endroits bizarres de la Guadeloupe. Près d'un champ de bananes, près d'une forêt, près d’un fond. Ça a éveillé mon imagination. Elle était professeure d'histoire, elle savait très bien comment mener son histoire pour susciter ma curiosité. Je la remercie. C'est grâce à elle que j'ai plongé dans cet univers. Puis, comme je disais en étant en Ile-de-France, j’ai voulu garder ce lien. J'ai commencé à lire les livres sur les contes et légendes pour garder ce lien et puis surtout pour continuer de le faire avec ma propre fille. Je lui raconte beaucoup d'histoires des îles. Et puis, moi aussi j'invente. J'invente en m’adaptant à ce qu'elle aime et ce qu'elle n’aime pas et cetera pour qu’elle garde aussi ce lien.
M : Oui, la transmission.
V : C'est important. Moi je trouve qu’il faut garder ce lien quoi qu'il arrive. Si ce n'est pas avec les contes, c'est en essayant de lui parler en créole ou de cuisiner antillais parce que je ne veux surtout pas qu'elle oublie.
M : C’est vrai, comme tu dis, la place des histoires et des contes est très présente. Toi, ça a été ta tante. Moi, ça a été mon père, ça a été des ami·e·s. Ça a été tout le monde autour de moi qui m’ont raconté des histoires différentes. Je pense que tout·e un·e chacun·e on a une version différente des esprits même s’ils reviennent toujours à peu près à la même description. J'ai grandi avec un sac chez moi où mon père gardait ses fioles. Sur ces fioles, il pouvait y avoir écrit « esprit de l'homme », « âme de l'homme ». C'était beaucoup de spiritualisme. J'ai beaucoup baigné dans tout ce qui était magico-religieux. Je vivais à côté de bois et à côté de champs, c’est-à-dire que la nuit lorsque mon chien, et c’était un chien créole, se mettait à aboyer je me disais toujours : « Mon dieu qu’est-ce qu’il y a ? ».
V : Mon dieu !
M : Il pouvait ne rien avoir mais malgré que l’on grandisse dans toute cette atmosphère, on en est convaincu·e. C'est assez marrant pour ma part personnellement je suis athée mais la présence des esprits, j'y crois dur comme fer. Pour moi, ça fait partie de toute la vie vivante des Antilles, même si c'est la vie de l'au-delà. C'est une vie vivante. Et la place que ces esprits est vraiment importante. Comment tu décrirais, toi, la place du magico-religieux dans nos sociétés, de ta place de Martiniquaise ?
V : Alors il a fallu que je me coupe de mon île pour voir vraiment la place du magico-religieux dans les Antilles. Lorsque que j’habitais là-bas, j'y ai vécu jusqu'à mes 23 ans, c'était tellement dans le quotidien tout ça que je ne faisais pas attention. J'étais catholique à l’époque. J'allais à la messe, j'étais au catéchisme et cetera pourtant, j'avais aussi ces petites pratiques. Dans ma tête, je ne faisais même pas le lien en me disant : « Ah, c'est du magico-religieux. Ah ça, c'est de la pratique du christianisme. » et cetera. C’était tellement lié. Et mon entourage pensait pareil. Mes ami·e·s me disaient : « Ah, j'ai vu un esprit hier ! ». Je leur répondais : « Ah oui ? Alors fait attention. » sans vraiment y penser puisque c’était tellement lié et imbriqué.
En faisant cette coupure avec mon île, j'ai pu prendre du recul et voir que finalement il y avait du catholicisme et il y avait aussi du magico-religieux et j'ai pu faire la séparation. Le fait de lire les contes et légendes, de m’y replonger et de parler avec des gens qui ont le pied dans l'invisible, et cetera, j'ai pu faire la différence et vraiment m’y consacrer. Depuis, j’ai mis de côté la religion catholique, je ne m’identifie plus à cette religion. Ça m'a permis de voir que dans notre société personnellement, je dis bien personnellement parce que chacun·e à sa vision, que le magico-religieux est très vivace dans nos îles. C’est très vivace. Par exemple : Malgré le fait qu’un·e tel·lle va à l’église, ça ne va pas l’empêcher de mettre du sel sous le paillasson ou de se dire : « Je sens quelque chose dans la maison. Olalala ! Culotte à l’envers, culotte noire à l’envers ! » ou que sais-je du bois de moudongue [4] devant la porte.
M : C’est vrai !
V : Et tout ça sans problème. Les gens vont à l'Église le dimanche et puis illes vont faire des sacrifices pour les divinités hindoues. Alors là ! Je les connais. Il faut voir ça mais ça ne pose aucun problème. C'est pour te dire que c'est très imbriqué dans la vie quotidienne. Néanmoins, je trouve que c'est en danger par rapport à la montée du christianisme et de l’évangélisme. Nous sommes après tout une île christianisée [5] [6] [7]. On entend trop de personnes disant que : « C'est diabolique ! C'est l'œuvre de Satan ! Mon Dieu des esprits ! Mon Dieu, c'est Satan ! ». On perd l'envie de connaître et d'approfondir le sujet afin de se rendre compte que ce n'est pas diabolique en soi, ce sont des reliquats des cultures ancestrales. Bien évidemment, il y a des gens qui l'utilisent pour faire du mal comme dans toutes les religions, on ne va pas se mentir. Pourtant, à bien y regarder ça n’a rien à voir avec le diable, le Satan chrétien par exemple.
M : Et comment tu décris alors la place de ces esprits ? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de quelques esprits que tu connais ?
V : Quelques esprits ? J'ai un exemple. J’habitais à Godissard [8] et on dit que Godissard s'est construit sur un cimetière d'esclaves. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas trop cherché mais c'est vrai que ça m'a déjà arrivé de voir quelqu'un qui passait et qui disparaissait, donc je me disais : « Bon ! Ça n’a pas l’air d’être une voisine. La personne me parait un peu bizarre. Bon ! Je retourne sur mes pas ! ». Ça m'est déjà arrivée de rentrer chez moi à 3h du matin et de voir des gens qui passaient et qui disparaissaient. Et je ne suis pas la seule à les avoir vu, lorsque j’en parlais avec mes copains et mes copines c'était la même chose. J’anime actuellement sur ma page Instagram un appel à témoignages des mystères occultes de nos îles, beaucoup de gens m'envoient des témoignages et me disent : « Voilà, j'ai vu ça. J'ai été témoin de ça. ». Moi, je pars du principe que je les crois. Je crois. C’est vrai qu’il y a des histoires où je me dis : « Bon je ne vais pas aller à Gourbeyre [9]. Je ne vais pas aller à tel endroit en Martinique » !
M : On rigole, on en rigole beaucoup mais la place des esprits et des esprits en tant que tels sont très vivants parce que les personnes continuent de transmettre leurs histoires, continuent de transmettre leurs actions. Qui sont-ils ? Je t'avoue que je ne connais pas trop les esprits en Martinique. Je sais que le dorlis [10] martiniquais finalement est le succube en Guadeloupe mais je ne sais pas si vous avez le soukougnan par exemple, je ne saurais dire.
V : Non, le soukougnan c'est typiquement de la Guadeloupe, j’ai l’impression. Après peut être qu'il y a des soukougnan en Martinique mais sous un autre nom.
M : En effet, ces histoires on les connait. Par exemple, le soukougnan, on lui donne des attraits de vampire. D'autres disent qu’il serait là pour punir les ancien·nes esclaves. À la vérité, la façon dont j'ai pu apprendre l'existence des esprits avant que mon père m'en parle, c'était quand j'étais en colonie de vacances. Je devais avoir 8 ans. On m'a expliqué qu'il y avait eu un sorcier vaudou qui, pour punir les maîtres esclavagistes, avaient relâché les bêtes de l'enfer mais que la déveine des nègres·ses était telle que les créatures au lieu de s'attaquer aux esclavagistes, ils se sont attaqués aux nègres·ses. C'est pour cela que les Antilles demeurent l'habitat de ces créatures, puisqu'il y a toujours les personnes à terroriser et ce sont les nègres·ses. J’ai entendu cette version et d’autres. On se rend compte à quel point tout cet univers de l'au-delà, tout cet univers du magico-religieux est bien présent. Par exemple les seules personnes qui roulent sur une poule blanche égorgée dans un quatre de chemin sont les touristes. Personnes d’autres !
V : Personne !
M : La poule va moisir dans le quatre chemin de la personne.
V : Ou un crapaud crucifié. Et attention ! Le crapaud avec le costard à sa taille. C’est très important ! Ça c’est au Terre Sainville [11], j’y habitais avant. La personne qui a pris son temps de prendre sa machine et de coudre à la taille du crapaud un costard était déterminé·e ! Personne n’osera prendre une photo comme les touristes ! Non, non ! On passe notre chemin. On fait comme si on n’avait rien vu !
M : Un crapaud avec un costard !
V : Oui ! Ça s’appelle Golgota. Un crapaud, un anolis et avec je-ne-sais-plus quoi font un triangle. On l'utilise beaucoup pour les procès en cours. Pour que la justice aille en notre faveur en général. Je tiens à préciser que je ne suis pas une quimboiseuse [12] ! Ne venez pas m’envoyer des messages pour me dire comment on doit faire si ou ça. Non, non, non ! Je sais certaines choses parce que je connais certaines personnes qui pratiquent mais ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler quoi que ce soit ! Je n’ai pas envie que l’on sonne chez moi pour trouver une ombre devant ma porte et me dire : « Pè djèl ou ma fille [13] ! (Tais-toi ma fille)». C’est toujours avec modération.
M : Savoir qu’il y a toute une communauté de personnes, toute une société, puisque que ce soit en Guadeloupe, en Martinique... Je ne connais pas les pratiques religieuses de la Guyane ni de la Réunion.
V : De la réunion, j'aimerais savoir, mais je ne sais pas vraiment. Je n’ai pas trouvé de bouquin qui m'expliquent vraiment mais ce serait intéressant et voir s’il y a un lien avec la Guadeloupe et la Martinique.
M : En tout cas, partant des îles sœurs donc la Guadeloupe et la Martinique, on se rend compte à quel point la question de l'esprit et la question du quimbois... Le quimbois pour l’expliquer assez vulgairement est un peu le jeu du culte c'est-à-dire que l’on va voir quelqu'un qui va jeter des sorts sur d'autres.
V : Pas forcément jeter des sorts sur quelqu’un·e. On peut utiliser le quimbois pour améliorer sa vie ou par exemple lorsque l’on sent que l’on est accablé·e par une déveine. On va avoir un·e quimboiseur·euse pour dire : « Ah, je sens que la malchance me poursuit. ». Iel va faire en sorte de rebriller l'étoile, notre étoile. Ou guérir une maladie ! J'ai toujours dis qu’il ne faut pas les voir comme la personne qui ne jette que des sorts. Ça, il y en a qui le font très bien. Ça on le sait.
Toutefois, ce n’est pas que ça. C'est quelqu'un·e qui peut te guider avec des plantes en te disant : « Prends telle plante et puis fait telle prière catholique ou indienne. ». C’est tout un mélange. Il y en a même qui utilise le Coran c’est pour vous dire. Il y a de tout mais il ne faut pas voir les quimboiseur·euses comme un·e sorcier·ière qui ne lance que des sorts et qui veut punir un·e tel·le.
M : Oui. C’est vrai que de ce côté-là, des esprits, du quimbois, du Gadèzafè, tous ces outils, finalement, du magico-religieux, sont vraiment très respectés. Pourtant, comme tu l'as dit, il y a maintenant une sorte de révolte puisqu'on a de plus en plus de personnes qui attribuent tout cet univers du magico-religieux à Satan. Quelque part lorsque tu dis que ce n'est pas de l'œuvre de Satan, j'aurais bien aimé savoir comment tu décris la nécessité ou peut-être que je m'avance en disant la nécessité, mais comment tu décris ce contexte ? Comment tu décris tout ce monde du magico-religieux et pourquoi est-ce crucial de conserver ce culte du mystique ?
V : Pour commencer historiquement les africain·es mis·es en esclavage aux Antilles ont été sujets à une grande propagande de l'Église pour rejeter toute leur culture ancestrale. Leurs pratiques vaudou, igbo, yoruba, ont été diabolisées. L'esclave se retrouve dans une petite île qu'iel ne connaît pas avec des noms qu’iel ne connaît pas et on lui dit que tout ce qu'iel a appris, c'est l'œuvre du diable, et cetera et qu'il faut abandonner tout ça. On a appris que tout ce qui se passe sur le continent africain est diabolique. On part déjà très mal.
Il faut commencer à se dire non, ce n'est pas diabolique. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui l'utilisent pour le bien, il y en a d’autres qui l’utilisent pour le mal. Mais pourquoi c'est important ? Parce que conserver notre magico-religieux permet de contrer l’assimilation. Cette idée qui voudrait que l’on soit des français·es à part entière avec la même culture française. Ça veut dire que l’on rentre dans le bain du latin avec le christianisme.
Or ce n'est pas possible pour moi. Je dis personnellement, ce n'est pas possible parce que nous sommes des antillais·es descendant·es d'africain·es, mis·es en esclavage. Pas d'esclaves mais d’africain·es mis·es en esclavage par sé moun tala [14]. Après l'abolition de l'esclavage, on a eu droit à : « Mes ami·e·s, sa fèt, sa fèt [15] oublions. ». Non ! On va de l'avant sans oublier. C’est très important sinon on ne saura pas où l’on va. Si on ne connaît pas notre histoire, je ne vois pas où on peut aller. C'est important parce qu'il faut conserver ça par respect pour nos aïeul·es. Il faut faire tout ce travail de détricotage pour montrer que ce n'est pas si diabolique que ça. Si quelqu'un met un couvert devant un arbre et dit que c'est pour une offrande à l'arbre. Il faut tout simplement dire : « Oui compère comme tu veux, fait tes affaires. ». À l’inverse, il ne faut pas dire : « Oui missié fait des trucs bizarres. C’est occulte. C’est l’œuvre de Satan. ». Non ! Nos aïeul·es le faisaient et je trouve qu’il faut respecter ça surtout pour contrer l'assimilation.
Nous sommes une petite île face au grand monde occidental. Il faut que nous controns cette assimilation sans quoi nous allons nous faire manger et que l’on ne saura même plus ce que c'est un·e authentique antillais·e. C’est ce qui fait notre culture, notre différence et qui nous fait rayonner malgré tout à travers le monde. C'est important. Cette essence du magico-religieux fait partie de notre culture et doit être préservée. Heureusement ce travail est déjà fait dans la littérature Antillaise. Par exemple lorsque vous lisez du Confiant et du Chamoiseau, il y aura toujours un rappel.
M : Oui tout à fait !
V : Tu vois, tu sais déjà ! Et je trouve que ça c'est important parce que ça nous différencie de la littérature française.
M : Tu as également dit qu’il faut conserver aussi notre imaginaire collectif. Qu'est-ce que c’est que l’imaginaire collectif ?
V : L'imaginaire collectif selon moi, c'est un ensemble de croyances propres à une communauté. Par exemple comme on l’a dit, on a notre dorlis, soukougan et cetera. Tandis que l'européen·ne, par exemple aura ses sorciers et sorcières sur des balais. Je vais prendre par exemple le cas des islandais·es parce que ça m'intéresse. Les islandais·es ce sont des chrétien·nes mais illes croient dur comme fer au lutin. Malgré le fait qu’illes soient chrétien·nes, illes ont conservé cette croyance. Je trouve que c'est important et te respecte ça. Je n'ai jamais vu de lutin mais si un·e islandais·e dit : « J'ai vu un lutin dans mon jardin. ». Je vais lui dire d’accord, il n’y a pas de problème. Je ne vais jamais lui dire qu’iel est fou·folle ou que c’est farfelu ou encore que ça n’a rien à voir avec l’église. Je dis tout simplement : « Ok. Il n’y a pas de problème. Iel conserve cette imaginaire. Je ne sais pas si les lutins existent mais par contre je sais que les soukougnan et dorlis existent et qu’ils font partie de l’imaginaire propre à notre communauté antillaise. Je le redis, il faut le conserver pour combattre justement l'assimilation. Si on commence à croire que les sorciers et les sorcières volent sur des balais comme Harry Potter, on a tout perdu. On a tout perdu.
M : L’imaginaire collectif peut-être aussi une base qui nous permet de survivre. Dans toute cette culture du mystique, on y retrouve les bases permettant de soigner, de réparer et les outils pour aller de l'avant. Avec ces apparitions apparition soudaines que ce soit du soukougnan, que ce soit cet être aux yeux bleus ou Manman Dlo et cetera pour ne citer que des esprits connus en Guadeloupe [17], on va se lier à l’autre. On se lie à un·e autre guadeloupéen·ne. Ce lien entre nous a permis de créer et permet aujourd’hui de conserver notre identité. Si aujourd'hui je devais faire face à une personne, à un guadeloupéen ou guadeloupéenne qui me dit : « Les esprits, ce sont des balivernes. Ça n'existe pas » et qui renie tout en bloc, je me sentirais attaquée. Je sentirais ma culture attaquée.
La culture du mystique ce n’est pas seulement faire peur aux enfants ou de créer tout un tas de rêves ou d'idées, c’est créer une liaison. Ça crée un pont. Je te rejoins sur ce que tu disais, le pont entre les cultures. Ça crée aussi un pont entre les gens. Nous avons tout de même toute une société construite sur des ruines de cultures et d'ethnies dont on ne sera même pas les déterminer. C’est ce que l’on nous a retiré, le déracinement de nos ancêtres mis·es en esclavage a été aussi le déracinement de leur culture. On ne pourrait même pas savoir d'où l’on vient exactement tout ce que l’on sait, c'est que l’on a ces ruines. Et sur ces ruines, il y a toute notre résilience en tant que guadeloupéen·ne, martiniquais·e, guyanais·e et réunionnais·e. Au travers de cet imaginaire collectif, ce sont les moyens que nous avons pour nous lier en tant que communauté et rester soudée.
V : Oui. Tu as tout à fait raison. C'est un lien entre nous et c’est un bloc. Un bloc pour que l’on garde cette identité intacte. Même si l'Extérieur nous dit : « Ah, c'est farfelu ! Les esprits ?! C'est quoi ça, c'est quoi ? Mettre du sel sous le paillasson c'est quoi ces histoires ? ». Eh bien, on le fait. On le fait.
Sur mon podcast, j’avais fait un épisode sur ce sujet, sur les superstitions que l’on médise. Par exemple, mettre du sel sous le paillasson ou ne pas balayer la nuit parce que les esprits vont être dérangés. Ça peut être vu comme des superstitions mais moi je trouve que ce sont des petits gestes de la vie quotidienne qui nous permettent de contrer d'une certaine manière l'assimilation. Lorsque l’on regarde les superstitions en Afrique, par exemple, je sais plus dans quel pays africain je m'en rappelle plus, il est dit que balayer à partir de 18h dérange les esprits et nous, on a la même chose aux Antilles ou en tout cas en Martinique. Je me dis que les gens extérieur·es disent que ce sont des superstitions alors que c'est un héritage que l’on a même si on ne le comprend pas. Ce n’est pas grave, on le fait. C’est tellement inné. Nos petites manières un peu farfelu comme illes disent font partie de notre identité qui s’est construite comme tu dis sur des ruines.
M : Pour pousser la réflexion sur ce sujet, lorsque je pense aux esprits, et notamment à cette toute nouvelle saison du podcast, je pense à l’identité. Si je pense encore plus à mon identité, je me dis, est-ce que les esprits ne seraient pas nous-mêmes ? Est-ce qu'ils ne seraient pas des allégories de nous-mêmes et surtout des allégories de notre traumatisme ? Et il y a toute une recherche que j'ai pu faire là-dessus, notamment partant du principe que chaque esprit a une histoire particulière, un choix de victimes particulier et une récurrence particulière. On ne va pas avoir les mêmes esprits entre la Martinique et la Guadeloupe, entre la Guyane et la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe. Encore une fois, on regrette de pas connaître les pratiques magico-religieuses de la Réunion. Il est en tout cas vrai que chaque esprits a véritablement une place particulière. Au vu, comme tu l'as dit, de notre héritage, parler des esprits, c'est aussi parler de personnes qui peuvent faire tellement plus que nous et qui sont capables de faire ces choses que nous n'arrivons plus à faire. Qui dans la vie de l'au-delà finalement, arrive à mettre...
V : Nous donne de l’espoir.
M : Exactement ! Si les esprits représentent nos malheurs, et ils représentent aussi nos bonheurs, c'est-à-dire qu'il y a certains esprits qui vont peut-être nous bénir de quelque chose, d’autres qui vont nous prévenir que quelque chose va arriver. Pour moi, l'esprit incarne quelque part nos traumatismes. C'est l'affirmation que je fais dans mon article qui, petite publicité pour ma part est en en lecture libre sur mon site. Je dirais également que les esprits représentent nos moyens de défense pour survivre dans une réalité qui est la nôtre. Comme tu l’as dit, on nous a dit : « Vous êtes désormais citoyen·ne. ». Qu’est-ce que ça veut dire ? Passer des années d'oppression et de servitude pour être finalement libre, libre dans quoi ? Libre dans la plantation ? Libre de faire quoi ? Tu n'as pas de terre, on te donne aucune réparation, on ne te donne absolument rien.
V : Et on te donne le chlordécone ! Puis fait avec !
M : Exactement. Très souvent je me dis, raconter les esprits, c'est raconter aussi nos blessures et ces esprits finalement réussissent à faire quelque chose que nous, en tant qu’êtres vivants, nous n'arrivons pas à faire. Donner à ces esprits des forces surnaturelles, ils ont des capacités inhumaines.
V : Et c'est thérapeutique. J’aimerais un peu approfondir sur les esprits thérapeutiques. Par exemple, je vais prendre le vaudou. Dans les cultes du vaudou, il y a les possessions. « Agoué est venu sur moi. Je commence à faire comme Agoué ou Ezili-fréda-Dahomey commence à venir sur moi. ». Moi, je veux bien y croire. Je pense aussi qu'il y a un côté thérapeutique dans le sens où le fait que la personne imite les attributs d'un esprit dans son subconscient, son esprit lui-même va se dire oui et va se convaincre qu'il est possédé. Le fait que son esprit va se convaincre qu'il est possédé, il va se guérir lui-même. Je prends l’exemple du placebo. Les études montrent que si l’on te donne un médicament et que l’on te dit : « Tient, ça va guérir ton diabète. » alors que je ne sais pas, il peut s’agir de sucre. Pourtant le simple fait de se dire que c’est un médicament révolutionnaire qui va te guérir peut en effet te guérir. Les scientifiques se rendent compte alors que la personne s’est guérie elle-même. Ça, c'est l'effet placébo. Moi j'ai envie de dire que la possession par un esprit, par exemple, fait cet effet placebo.
Pour autant, je ne nie l’existence des possessions. Il ne faut pas oublier que tout cet univers de la possession c’est-à-dire les costumes, les chants, les tambours et les offrandes, met déjà en condition ton esprit pour accepter ce petit effet placébo et qui permet te guérit toi-même. Je trouve ça fabuleux. Et il y a plein de théologien·nes qui ont étudié, par exemple la place di Quimboiseur·seuse, du Gadèzafè, iel aussi a ce côté thérapeutique. Iel peut te donner deux/trois plantes qui n'ont rien à voir avec la pathologie et dire : « Oui prends ça. Fait 7 jours de prières. ». Si tu es convaincu·e que ça va te guérir et que ton diabète descend, ou pa ni tansyon enk, ou pa ni kansè [18] et bien !
M : Bien sûr. Si on part du principe que ce sont des héritages que nous avons réussi à préserver puisqu'il fallait réussir à les préserver, ce qui n'était pas évident et qu'ils ont un tel impact sur notre société ; ils nous lient entre nous, ils nous guérissent, ils extrapolent nos souffrances. Personnellement, je pense que le soukougnan représente tout cet héritage de traumatisme, de souffrance que nous portons puisque le soukougnan est avant tout un·e esclave en colère, un·e esclave que l'on a martyrisé et que l'on a fouetté sur le fromager pour finalement lia laisser mourir d'une mort lente. Pour moi, ils représentent avant tout notre collectivité, en tant qu'individu, ayant réussi à créer toute une société et toute une culture sur un héritage également de résilience, mais et surtout de trauma.
V : Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais je tenais à aussi à dire que les dorlis existent ! Alors oui, c'est vrai à bien regarder l'histoire, on peut dire que c'est une projection de nos traumatismes et cetera. C'est vrai, je trouve que c'est très intéressant qu'il faudrait approfondir ce sujet, mais les dorlis pour moi existent. Ah mon dieu ! Bois moudongue devant la maison !
M : Ah c’est bon pour ça ?
V : Ah bois moudongue et plein d’autres choses ! J’ai déjà vu des choses... Pour moi franchement, il y a des gens qui sont capables, comme je l'ai dit, qui ont un pied dans l’invisible. J'ai des théories et suppositions qui peuvent évoluer selon les témoignages, selon ce que je vois, ce que je lis, d'où le fait de dire que c'est une quête.
M : Et où est-ce que va te mener ta quête ? Ou est-ce que tu penses aller notamment avec les témoignages que tu es en train de recueillir ? Qu'est-ce que tu espères accomplir ? Je sais que c'est pour la préservation de notre culture. Mais est-ce que tu espères mener quelque chose de plus pousser ?
V : Déjà, en lisant les témoignages, je me dis que je n’étais pas folle et que ce n’était pas mon imagination, tout simplement. J'ai toujours ce petit côté cartésien qui reste même si je suis très intéressée et impliquée par le sujet, j'ai toujours ce petit reliquat. Dans les îles, les esprits sont au quotidien avec nous. Je ne sais même pas. Peut-être qu'ils se promènent dans la rue et on ne le sait même pas. Et puis il y a des gens qui les voient. Moi, je ne les vois pas.
M : Ernest Pépin dans Toxiques Islands dit que les esprits marchent constamment près de nous, mais que nous ne les voyons pas. Ils représentent un monde parallèle parce que nous pensons aux morts, les esprits reviennent et protègent les vivants.
V : C'est tout à fait ça et il y a des gens qui ont cette capacité de voir ce genre de choses.
M : Les Kwafè [19] notamment.
V : Exactement. Illes ont cette capacité. J'ai eu des témoignages de personnes qui voient ce genre de choses et apparemment depuis qu’illes sont petit·es. Ça m'est déjà arrivé avec ma fille, par exemple, de la voir regarder le mur dans le noir de ses grands yeux. Elle dit : « Qu'est-ce que c'est que ça ? ». Je lui dit qu’il n’y a rien mais je ne suis pas sereine pour autant. Je me dis : « Oh la la ! Qu’est-ce qu’il y a chez moi ! ». Elle fixe le mur comme s’il y a quelqu’un·e. Ou bien elle parlait comme s'il y a quelqu'un·e en face d'elle. Je me dis que c’est le moment de brûler de la sauge !
M : Malheureusement, on arrive à la fin de cet échange. Si tu avais une citation ou bien quelque chose que tu souhaitais dire sur les esprits, s’il y a quelque chose qui notamment fait le résumé de ta quête justement, de ton travail sur la visibilité du magico religieux via la fleur curieuse, qu'est-ce que ce serait ?
V : J'ai lu dernièrement le livre d'Ena Eluther An Fonnkyè a péyi-la. Une phrase résume bien tout ça : « Fil à l'invisible ka koud é dékoud la vie. Fòs sé lèspri ka accompagné les vivants, jwè èvè yo, béni yo et gidonné yo. [20]» Cette petite phrase m'a fait sourire, je me suis dit, c'est exactement ça. Le livre est à retrouver aux éditions Nèg mawon, d’Ena Eluther. Je vous invite à le lire. Bientôt, j'ai mon propre livre qui va sortir, ça s'appelle Pawol pou makrèl . Je ne sais pas. J'aime beaucoup les commères et les makrèl. J’en suis une ! Mais je ne fais pas trop kankan. Moi je sais garder les secrets, je ne fais pas de kankan. J’écris des contes, donc Pawol pour Makrèl est un recueil de contes. Ne vous attendez pas à quelque chose joyeux !
M : Alors c'est parfait, ça veut dire que l'interview va pouvoir continuer en lisant tes contes, en lisant tes histoires. Est-ce que ce sera toujours sur les esprits ?
V : Oui, oui ! Sur les esprits, sur les pratiques et justement, ce sont des choses qui relatent des choses réelles. Je n’en dirais pas plus. Il y a en tout cas des pratiques qui existent mais je changerais les ingrédients pour ne pas avoir de problèmes ! Comme je vous ai dit, je ne veux pas avoir de problème avec les quimboiseur·euses. C’est pour ça que le format est le conte. Le conte fait la transmission des savoirs occultes de nos îles.
M : La transmission, est tout ce qui va intéresser cette nouvelle édition du podcast esprit, traumatisme et identité. Et je voulais justement commencer avec toi cette première saison notamment pour parler des esprits et parler de façon ouverte puisqu'on a la tendance aussi de garder sous la table ce que l’on a vu et ce que l’on croit pour ne pas perturber voisin·es et familles. C'est vrai que j'avais envie d'avoir cette conversation pour qu'on dédramatise le magico religieux et pour que l’on puisse lui permettre d'être à l'égal de notre musique, à l'égal de notre art. Et comme les bruits des tambours au TAC au TAC du rythme des îles, on raconte les esprits.
V : Très bien. C’est parfait ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que je pense.
M : Bien évidemment, avis aux personnes qui souhaitent avoir des conseils sur le Quimbois, comme Valérie l'a répété, elle n'est pas professionnelle. Je n’ai vraiment pas envie de dire au revoir mais il le faut.
V : Oui mais on est obligée, je sais. Une dernière petite phrase pour notre auditoire. Nos jardins créoles, préserver nos jardins créoles parce que le magico-religieux est lié au jardin créole à ses plantes et ses mystères. Préserver votre jardin créole c'est très important.
[1] Créole martiniquais, traduction : Je tiens
[2] Créole martiniquais, traduction : Mon cul en marre de
[3] Traduction : Mélange, confusion, méli-mélo
[4] Bois moudongue en Martinique ou Bois-Montagne en Guadeloupe est un arbuste ou petit arbre présent aux Antilles. Il est reconnaissable à ses petites baies rouges formées en grappes.
[5] Gabriel Debien : La christianisation des esclaves des Antilles françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles
[6] Gérard Lafleur : Religion des esclaves en Guadeloupe et dépendances de 1802 à 1848
[7] Philippe Delisle : Christianisation et sentiment religieux aux Antilles françaises au XIXe siècle : assimilition, survivances africaines, créolisation ?
[8] Godissard est un quartier de Fort-de-France
[9] Gourbeyre est une commune de Guadeloupe
[10] Le dorlis en Martinique ou le succube en Guadeloupe est un esprit qui s’attaque la nuit aux femmes. Pour s’en protéger il est conseiller de porter une culotte noire à l’envers. Je vous renvoie au livre d’Ernest Pépin l’Homme aux bâtons.
[11] Terre Sainville est un quartier de Fort-de-France
[12] Traduction : Sorcière
[13] Créole martiniquais, traduction : Tais-toi ma fille.
[14] Créole martiniquais, traduction : Par ces gens.
[15] Créole martiniquais, traduction : C’est fait, c’est fait.
[16] Manman dlo est une sirène. On surnomme également les lamentins Manman dlo.
[17] Si Manman dlo est un connu en Guadeloupe, trouverait ses origines en Martinique.
[18] Créole martiniquais, traduction : Tu n’as plus de tension encore et plus de cancer.
[19] Traduction: Personnes sensibles à la présence des esprits ou/et pouvant communiquer avec eux.
[20] Créole guadeloupéen, traduction : Qui coud et découd la vie. Force à ces esprits qui accompagnent les vivants, jouez avec eux, bénissez-les et guidez-les.
Ressources supplémentaires :
Christiane Bougerol :
Actualité de la sorcellerie aux Antilles
La sorcellerie aux Antilles : Interractions et malheurs
Ernest Pépin : L'homme-aux-bâton
Hector Poullet : Kenbwa an Gwada: le tout-monde magico-religieux créole
Lucie Gabourg : L'ombre du dorlis
Maryse Condé : Moi Tituba
Philippe Chanson : Le magico-religieux créolecomme expression du métissage thérapeutique et culturel aux Antilles françaises
Raphaël Confiant :
L’hôtel du bon plaisir
Eau de café
Zdenek Pokorný : La sorcellerie et le pouvoir magique dans la littérature de l’oralité de Patrick Chamoiseau